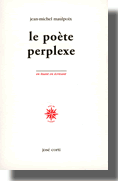« Dans l'incertitude, j'ai tendu la main »
sur L'Emportement du muet d'André Du Bouchet
Mercure de France éd., 144 p., 85 F.
par Jean-Michel Maulpoix
Article paru dans le numéro 797 de La Quinzaine littéraire
L'Emportement du muet
réunit neuf textes, proses ou poèmes, de diverses époques. Deux essais
datant des années cinquante, « Orion aveugle à la recherche du soleil
levant » et « Baudelaire irrémédiable », y précèdent une suite de
poèmes des années 80-90. Mais ici comme là, c'est le même travail
réflexif que poursuit l'écriture, la même poursuite mentale, dans la
lignée de ce que Mallarmé appelait naguère des « poèmes critiques ».
L'emportement du muet
: que désigne ce titre énigmatique ? Une « hauteur atteinte dans la
langue », un emportement « dans la matière volatile de la langue », qui
n'est nullement le fait de quelque souffle divin, passion soudaine, ou
bouffée d'inspiration, mais consiste en un « vouloir excessif », «
vouloir débordé », « vouloir en défaut », tentant sur le papier de «
s'ajuster à ce qui reste sans mesure ».
Qu'il
relise Baudelaire et Leiris, qu'il observe l'art de Poussin ou de
Tal-Coat, ou qu'il se mesure physiquement lui-même au paysage dans
l'épreuve de la marche, André du Bouchet apparaît conduit et tenu par
le constant souci de retrouver l'instant où soudain « un accident
rétablit (...) ce rien que nous sommes ». Moins excès que défaut,
l'emportement n'engendre pas un afflux de paroles, mais une écriture
faite de taches ajourées de trous : les rythmes et les emplacements
d'une « parole dans l'inaccompli porteuse de ce qui n'a même pas encore
été ». Au sommet du poème est ce point aveugle où la langue se
rapproche au plus près de ce qui lui échappe, perce son vêtement
familier, et se lave en sa propre défaite. Ainsi le poème offre-t-il à
qui l'écrit (ou le lit) la chance de se reconnaître comme le muet de sa
langue : non pas son chef d'orchestre, mais son passager ébahi, venu
buter sur le silence d'où tous les mots procèdent.
La
poésie est une parole en excès dans le langage et qui revient
obstinément cogner contre ses limites, ne pouvant par ailleurs ni se
soustraire ni se réduire à son travail d'enveloppement, auquel elle
participe : une parole contrainte de se regarder, se voir, explicitant
éperdument jusqu'au rien sa propre énigme. Tel serait « l'emportement
du muet » : à la fois un dessaisissement et la mise en intensité de la
perception du réel, l'atteinte d'une évidence brutale : nous sommes
cette présence qui ignore, qui questionne; nous sommes cette évidence
et cette stupéfaction. La langue creuse en nous le vide qu'elle y
remplit.
De cette épreuve, André du Bouchet retrouve par exemple la figure dans le fameux tableau de Poussin, Orion aveugle à la recherche du soleil levant
: les divins ancrages s'y étant évanouis, il appartient à de « vastes
formes telluriques » de souligner aussi bien leur retrait que la
désormais tâtonnante avancée de la stature humaine « dans l'immensité
de la nature sans nom » où le secret affleure. Le réel est en crue,
plus que jamais touffu, prometteur et indifférent, offrant un sol à la
fois « stable et incertain » au marcheur qui y doit éprouver sa tenue,
sa propre consistance : « Ce n'est rien, j'y suis, j'y suis toujours. »
De
même, relisant Baudelaire, André Du Bouchet souligne l'interdépendance
des deux postulations contradictoires qui travaillent son oeuvre : «
désir de monter » et « joie de descendre ». A chaque pas des Fleurs du Mal,
écrit-il, « le progrès est à la fois perte et réparation », de sorte
qu'en ce déchirement c'est la vérité du passage terrestre qui elle-même
fructifie : « La poésie de Baudelaire porte en elle le moment atterrant
où, parvenus au sommet comme au bas de la pente, nous retrouvons, nié
par lui, le sol unique, dans la déréliction, et, plus d'une fois, sans
être capables de dire pourquoi nous nous sommes mis en route. »
Tel
s'avère l'apprentissage propre à cet itinéraire en lignes brisées
qu'est le poème : ponctué d'essors et de chutes, il retrouve le réel à
proportion de son effort pour y échapper, et il lui faut accepter que
le vide aussi soit un sol, ou que l'échec et le défaut de la Beauté
sachent seuls autoriser la reconnaissance du vivant : « Baudelaire se
sent précipité dans un vide (le vide du vivant) à raison même de la
volonté, aussitôt qu'elle cesse de lui apparaître viable, de
s'abstraire de sa vie, et de la hauteur à laquelle il a placé
l'abstraction. »
L'idéal
avorte en poème : telle est la leçon du lyrisme. L'inconnu convoité
n'est en définitive rien d'autre que l'existence même. Qui n'a désiré
l'impossible a-t-il chance d'être jamais « rendu au sol, avec un devoir
à chercher et la réalité rugueuse à étreindre », ainsi que l'écrit
l'ardenais ? A-t-il chance de comprendre que l'inconnu et le sol même
ne font qu'un, que la question et l'évidence sont une même chose ? Si
quelque consolidation (plutôt que consolation) peut être espérée du
poème, ce n'est pas par l'ouverture d'une issue idéale permettant
d'échapper, ne fût-ce que momentanément, à la certitude de
l'irrémédiable, mais par cette réouverture du vide qu'il opère et cette
vérité du dénuement qu'il inflige, au plus près de l'évidence même
d'être là, mortel : « un poème à son tour n'est que cela :
momentanément le vide qui, tout aménagement ayant fait défaut, marque
son attenance à l'indicible vie particulière ».
Reconduire
chacun au plus ras de ce qu'il est, le remettre au monde comme un
nouveau-né qui saurait, voilà ce que le poème accomplit, retranché de
son « but divin », en son emportement muet. Alors « mourir reprend, où
il le faut, place dans le cours d'une vie ». Aussi est-ce bien à la
fois « l'horreur de la vie et l'extase de la vie », indissolublement
liées, que fixe obstinément la poésie, en renversant « l'ailleurs
attendu en un ici qui prend de court ».
Le
réel est le puits dans lequel tombent toutes nos questions : il nous
désaltère aussi bien qu'il aiguise notre soif. En ce trou d'ignorance,
l'oiseau qui n'en sait rien vient nicher son chant, tandis que l'homme
y puise le souffle de sa langue. Ce souffle, il l'adresse et il le
partage : en poème, il le publie. C'est dire qu'il n'est là « rien de
singulier qui d'une façon ou d'une autre ne se découvre commun, et
enfin, c'est-à-dire de nouveau partagé. »
Parce
qu'il demeure ignorant, le poème peut tendre la main « pleine de
vérité, vide aussi bien que pleine ». Cette « appellation de rencontre
» qu'est la poésie, solidaire de ce qui demeure sans nom, répète en
direction d'autrui ces mouvements de langue : offrir un fruit ou lancer
une pierre (« atteinte à une tête », « atteinte à la parole », «
atteinte du vif »), ouvrir ou refermer la main, la tendre dans
l'incertitude.
© Jean-Michel Maulpoix