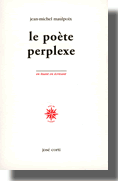Valère
Novarina au Petit Palais, le 2 février 2010, dans le
cadre du séminaire "La Poésie pour quoi faire
?" animé par Jean-Michel Maulpoix.
LA PAROLE SURACTIVE
par Jean-Michel Maulpoix
Essai sur Devant la parole (P.O.L), de Valère Novarina
Il faut lire et relire
Devant la parole. Dialoguer lentement, crayon en main, avec ce livre aigu. Tendre au profond de soi l'oreille: c'est notre parole même qu'il ébranle. Se pencher vers le fonds du puits : là se tiennent les mots. Y descendre...
Ceci n'est qu'un trop bref journal de lecture. Les premières bribes d'une conversation silencieuse. Inachevée, donc à reprendre.
Il faudra relire et répéter longtemps Devant la parole...
***
Voici une pensée de la langue qui est pensée de la parole. C'est dire qu'elle prend moins en considération le langage ou la langue que « le mystère de parler », cette « expérience singulière que fait chaque parlant, chaque parleur d'ici, d'un voyage dans la parole. » Ce voyage là, chacun l'effectue en son propre corps, à ce corps mortel défendant, rendu comme étrange ou étranger à soi dans l'acte même par lequel il croit se dire. Comment les mots existent-ils en nous ? Voilà bien la question posée.
Valère Novarina répond : la poésie, c'est de « l'alcool d'homme », le très volatil distillat de l'existence et de la chair, le soufflle de « notre habitat léger », de notre corps de « pauvre terre ». La poésie est « une parole soufflée dans le bonhomme de terre ».
Par la parole, je suis étrange, je suis vivant. La langue fait mémoire : oeuvre ou réserve, elle se dépose en alluvion sur la réalité. La parole s'élance et recherche : elle fuit, elle s'enfuit, elle souffle
A l'intérieur sont les ailes de l'homme : deux poumons qui font le souffle, deux sacs d'air d'où sort la parole. Des ailes non pour l'envol, mais pour le poème. Au dedans, le battement du proche et du lointain. Au dedans, l'Azur. Au dedans ce vide qui aspire l'espace. A ce dedans, pour ces poumons-là, il faut une bouche.
***
Impression d'arrière-monde
Quand l'homme croit voir s'entrouvrir des arrières-mondes grâce au langage, il se leurrre : il prend pour un accès à l'au-delà ce qui n'est après tout que l'étrangeté de sa parole. Il croit entrevoir un autre monde dans ce qui accuse l'énigme de celui-ci. Ainsi construit-il ses croyances et ses églises avec ce qui devrait lui servir à les renverser.
En quelque langue et religion que ce soit, Dieu n'est jamais que le nom donné par des hommes à ce trou d'air et de sens par lequel ils parlent et respirent, cette ignorance et ce silence d'où sourdent leurs pensées et leurs paroles.
La parole creuse le monde. Elle le mord et le mâchonne. En même temps que de la négativité, elle y introduit du sens. Si l'office de la Parole divine fut de créer les choses, la tâche propre à la parole humaine serait plutôt de les nier. Les faire sortir de l'espèce d'inertie où la parole divine les a laissées.
Quand le monde est tout encombré d'objets, quand la langue accumule les slogans et les petites phrases toutes faites, quand l'espérance ne trouve plus de chemins par où passer, que reste-t-il d'autre que la négativité humaine pour fuir cette asphyxie : cela qui réclame et résiste, cherche, interroge et ne se satisfait pas. Ce noyau dur de l'humain est la parole. Notre grande phrase.
Imaginer un violent trou d'air par où souffle un vent résistant.
L'homme existe de différer sa connaissance. D'attendre, de chercher, de ne pas savoir... Ecrire avec et dans ce vide, cette ignorance. Subsister ainsi sur la terre, y faire oeuvre mémorable, et prendre quotidiennement sa mesure par inaptitude à demeurer autant qu'à mesurer.
***
Crucifixion, respiration
De la division procède le lyrisme. D'abord pour tenter la suture. Ensuite pour en découdre. Creuser encore la plaie. Non pour clouer silencieusement l'homme à sa croix mais pour faire danser la parole dans sa déchirure.
Sur la scène, une crucifixion latente. On y verra couler le souffle et le sang de cette parole qu'est l'homme : « ici a lieu, devant tous, l'effusion de la matière humaine qui est la parole ». Effusion, non pas romantique, du coeur et de ses larmes, mais de la langue soufflée. Diffusion de la langue jusqu'à expiration du souffle, divulgation de tout le sang possible. L'homme vient mourir tout haut et devant tous en se vidant de soi. Il va « par le vide vers la vie, la vitesse. »
Voici le poète pareil à ce « Jésus crucifié enfant » que Novarina découvre dans « La Madone entourée d'anges et de saints » de Piero della Francesca : un corps céleste, aérien, tombant sur la terre, figurant en ce mouvement aussi bien son apparition que sa disparition : « celui qui naît et expire devant nous tient liés le début et la fin dans une grande figure respiratoire comprenant le temps tout entier. »
L'oeuvre même est cette figure respiratoire, cette fusion de la naissance et de la disparition en un moment unique, le sien, celui de son souffle, cette conjonction-disjonction où rien n'apparaît que pour disparaître et pour dire la disparition. Ici, « expirer et surgir sont un seul geste. » Tel est le poème en sa fabrique et sa combustion de langue.
***
Une affaire de main.
La poésie : affaire de souffle et de main. Car « l'organe du langage c'est la main ». Il suscite et réclame des actes.
Voici par exemple deux affaires de main dont s'occupe le poème : le toucher et la poignance. Le toucher émeut, sensibilise, palpe et caresse la forme, fait naître la musique, modifie le rythme du coeur... La poignance est aussi bien l'extrémité du toucher le plus aigu que l'extrême fermeté de la poigne, la capacité de la langue à tenir ou contenir. Là où le toucher passe, la poignance demeure. Là où l'un s'enfuit, l'autre vous retient. Que serait l'un sans l'autre qui assure son intensité ?
L'écriture est ce geste portant sur la langue, qui vise à accentuer sa matérialité, sa visibilité. Faire en sorte que prennent corps tous ces mots que nous parlons quotidiennement sans les voir. Que leur remuement devienne perceptible. Que cette pâte humaine qu'ils constituent ressemble à celle qu'un peintre travaille sur son tableau.
Tableau, n'est-ce pas un mot du théâtre autant que de la peinture ? L'écriture de Novarina rapproche la page, le tableau et la scène : espace poétique, espace théâtral, espace scénique, voilà ce que l'écriture ajointe. Agitant la langue, la traitant comme un matériau, elle fait du théâtre le lieu de la suractivité du poème : « le théâtre est le lieu où faire apparaître la poésie active, où montrer à nouveau aux hommes comment le monde est appelé par le langage. »
***
Quels étranges gestes sont les nôtres, gigognes et somnambuliques, chacun tâtonnant vers d'autres substances, d'autres corps que ceux qu'il lui est donné d'étreindre, et chacun recélant d'autres gestes encore, en direction d'autre chose. Comme si tout cela, ici-bas, n'était que prétexte, une illusion d'optique ou une erreur de perspective. Songe, disait-on naguère.
***
La parole est-elle autre chose que la manifestation (la preuve ? la démonstration ? la cause ? la conséquence ?) de notre distance aux choses : que des mots ainsi s'interposent et circulent entre moi et moi-même, entre moi et le monde, entre autrui et moi-même, n'est-ce pas la marque de ce défaut auquel l'existence même est adossée, de cette ignorance et ce porte-à-faux qui nous veut toujours décalés, un peu ici, un peu ailleurs, toujours les mêmes et déjà autres, suspendus, en instance, devenant et n'étant jamais que ce devenir même, poussant nos voix, nos gestes et nos figures dans le temps fait de signes.
© Jean-Michel Maulpoix