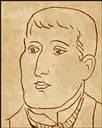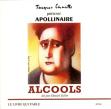|
"Ouvrez-moi
cette porte où je frappe en pleurant..."
De
même qu’il existe une porte d’entrée dans la poésie moderne
« nommée » Baudelaire,
une autre transitant par l’œuvre de Mallarmé,
et une autre par celle de Rimbaud, il
existe une entrée Apollinaire… A des titres différents,
tous ces poètes sont « de grands commenceurs », pour
reprendre un mot de René Char, même si, en chacun d’eux, l’esprit de
crépuscule est également à l’œuvre…
Apollinaire
entre deux mondes
C’est, me semble-t-il, à la porte
du nouveau siècle qu’Apollinaire frappe « en pleurant » :
c’est avec des motifs élégiaques et
sur des airs anciens qu’il fait dans les excitantes nouveautés de la
« Belle époque » son entrée…
Pierre Brunel
a fort justement intitulé Apollinaire entre deux mondes
la précieuse étude « mythocritique » qu’il consacre à
ce poète. C’est en effet entre XIXe et XXe, entre l’Ancien et le
Nouveau, comme entre « Ordre » et « Aventure »,
en avant et retournement, intimité
et universalité, mythologie antique ou médiévale et modernité que le
poète pose sa voix lyrique propre.
Cet entre-deux constitue le poème en
espace dialogique, expressif, conflictuel… où s’éprouvent
les divers degrés de la familiarité et de l’incongruité, de la
banalité et de l’érudition, comme s’il ne s’agissait plus
vraiment d’opposer (ainsi que s’y employait encore Rimbaud)
le noble et le vulgaire, mais de les rapprocher d’aussi près que
possible. Ce qui revient à inclure à part entière dans le lyrisme
ses chutes mêmes, comme à envisager une présence moins mordante et
plus ludique de l’Ironie à ses côtés… Avec Apollinaire et
quelques autres de son temps, une
nouvelle plasticité du poème se fait jour.
Plasticité que l’on pourrait dire
temporelle et spatiale autant que formelle, puisque son œuvre sollicite
à la fois une multiplicité de formes classiques ou novatrices, une
multiplicité d’époques et une multiplicité de lieux. On pourrait même
la dire menacée d’émiettement si la Voix lyrique n’assurait le
liant, la continuité entre ces éléments hétérogènes…
Que dire de
Guillaume ?
Une
vie brève :
Naît en 1880, meurt en 1918, à 38
ans, dans l’épidémie de grippe espagnole qui ravage Paris. Après
avoir été soldat dans l’artillerie à la Grande guerre, blessé à
la tête et trépané en 1916.
N’est pourtant pas de la famille
des « maudits ». Figure plus légère, plus « artiste »
que celle des grands auteurs de la fin du XIXe. N’attache pas à la poésie
une valeur suprême. Même s’il s’inscrit volontiers dans la
filiation orphique et apollinienne.
Pas un météore comme Rimbaud,
mais un poète charnière ayant vécu 20 ans dans le XIXe et 18 dans le
XXe…
Un
lyrique
Pour André Breton, « Guillaume
Apollinaire est le lyrisme personnellement ».
Lyrisme
dans les deux sens : expression personnelle et exaltation :
il y a dans l’œuvre poétique de Guillaume Apollinaire à la fois une
importante part d’expression subjective, personnelle, mélancolique
et sentimentale et une insistance présence des motifs de l’envol
(Christ aviateur, oiseaux…) et de l’inflammation enthousiaste (image
prépondérante de l’ivresse suggérée dès le titre). A cela
s’adjoignent d’autres importantes composantes de la donnée lyrique,
tels que la musique (chansons, romances…), la flânerie (les poèmes
composés en marchant), les motifs aquatiques…
Ces éléments qui entrent dans la
composition de la poétique apollinarienne sont également des données
de sa personnalité, de sa vie affective.
Un
étranger
Guillaume Albert Wladimir Alexandre
Apollinaire de Kostrowitzky est le fils naturel d’une jeune camériste
polonaise de 22 ans. Son père Francesco Flugi d’Aspremont, ancien
officier de l’armée royale des deux Siciles, bel officier séducteur
qui ne le reconnaît pas et se sépare de sa maîtresse en 1885.
Apollinaire naît à Rome, passe son
enfance à Monaco et à Cannes, fait sa rhétorique au lycée de Nice,
puis s’installe avec sa mère et son plus jeune frère à Paris en
avril 1889.
Sa mère mène une vie décousue et
bohème prétendument aristocratique. Elle change souvent de meublés.
Il lui arrive aussi de changer de nom.
Au sens baudelairien, Guillaume est un
étranger : l’amoureux des « nuages qui
passent »…
Sujet en fuite, sans racines
- Cosmopolitisme : sujet d’aucune province, proche
des émigrants
- Culture de bric et de broc conjuguée à d'assez
solides bases classiques.
- Goût également pour le moyen âge : il fréquente
la bibliothèque Mazarine
pour y consulter des textes médiévaux.
Va revendiquer, avec une certaine
complaisance, son statut d’émigrant et d’apatride, de bâtard et de
métèque, dans une époque où commencent à se développer les
« campagnes nationalistes, xénophobes, antisémites. »
Son oeuvre pose radicalement la
question de l'identité lyrique.
Un
fabulateur
Apollinaire entretient volontiers le
mystère sur ses origines. Il encourage les rumeurs sur son ascendance
(fils de prélat…)
« Les nouvelles, c’est-à-dire
les contes, sont ma chose » (Lettre à Tzara) : goût pour
l’imaginaire, la fabulation, le merveilleux. Son enfance a été
nourrie par les contes de fée et les romans de chevalerie. Perrault fut
sa première lecture principale.
Jeu entre le vrai et le faux, la vérité
et le mensonge (motif du « faux amour » et des « fausses
femmes » dans « La chanson du mal aimé »
Cf l'histoire peu claire du vol des
statuettes au Louvre...
Un certain goût pour l’obscur, le
rare, le précieux, le déroutant.
Un
sujet fantasque et complexe
- Goût pour l’épice du bizarre et du déconcertant, les
mots rares qu’il relève parfois par listes dans le dictionnaire
- Sensibilité et brusquerie. Fantasque, facilement furieux.
- Un côté érotomane et « mal aimé ». Goût
marqué pour la sensualité, la vie charnelle. L’écriture érotique,
le libertinage volontiers farceur, le retiennent : « Dame de
mes pensées au cul de perle fine ». Est parfois passé pour un
pornographe aux yeux de ses contemporains (entre sa 20e et sa
30e année, il publie sous le manteau des romans érotiques
« Mirely ou le Petit Trou pas cher », « Les Onze mille
verges », « Les Mémoires d’un jeune Dom Juan »).
-
Goût pour les bouges, les bars, les univers glauques et
cosmopolites où se mélangent maquereaux, bohémiennes et prostituées :
« J’aimais les femmes atroces dans les quartiers énormes »…
On en revient ainsi au cosmopolitisme
du début. La boucle du portrait est bouclée…
Physionomie
de L’œuvre
Alcools n’est qu’un
morceau d’une œuvre très abondante avec contes, récits, textes érotiques,
textes dramatiques, chroniques… Grosse activité littéraire.
Apollinaire publie dans les revues de l’époque telles que « Le
Festin d’Esope » qu’il a lui-même fondée en 1903, « La
revue blanche », « Le Mercure de
France », « La Plume »...
Dès 1900 (à 20 ans), il propose une
pièce à un directeur de théâtre. Puis en 1901, il compose un roman
« La Gloire de l’Olive », qu’il égare dans un train
entre le Vésinet et Paris. Il est l’ami des peintres et des écrivains
de l’époque.
Sa première œuvre connue est
« L’Enchanteur pourrissant » qu’il publie en volume en
1908, accompagnée de gravures de Derain.
Deux pôles principaux :
Alcools 1898-1913 : le pôle
« ancien » ?
Calligrammes 1913-1918 :
le pôle plus « moderne », avec ses calligrammes d’abord
appelés « idéogrammes lyriques » par leur auteur.
Mais dans le premier volume prédomine
la voix, dans le second un lyrisme visuel.
Entre les deux vient s'inscrire la célèbre
conférence de novembre 1917 sur « L’esprit nouveau et les poètes »
Alcools
Alcools
est paru
au Mercure de France en avril 1913. Tiré à environ 600 exemplaires
dont 350 seront vendus la première année, ce qui n’est pas négligeable.
La
composition
Les
dates en sont données par le sous-titre 1898-1913 (quinze années).
Né en 1880, Apollinaire a 18 ans en 1898. En 1913, à 33 ans, il
est un des principaux représentants de l’avant-garde
Cette
période de composition va de la fin du symbolisme à l'affirmation
de « L’esprit nouveau » et à la veille de la Première
guerre mondiale.
Pendant
ces quinze années, Apollinaire a ébauché plus de 250 poèmes
b)
Les séries, les séquences chronologique
-
("Merlin",
"Le Larron", "L’ermite", "L’adieu"...)
-
1901-1903 :
L
a
féconde période des Rhénanes (près de la moitié
des poèmes d’Alcools sont composés en 1901-1902) et de
l’amour pour Annie Playden : "Les colchiques",
La synagogue, "Rhénanes d’automne", "Les
femmes", "Le vent nocturne", "Les sapins",
"Clair de lune".
1902 :
suite des Rhénanes : "Nuits rhénanes", "Mai",
"les cloches", "la Lorelei", "la tzigane",
les deux premières strophes de "Fiançailles"
Apollinaire
est alors précepteur en Rhénanie chez une riche allemande, la
vicomtesse de Milhau.
1903 :
"La Chanson du Mal aimé" : en 1903 Apollinaire
compose une grande partie de ce poème achevé en 1904. C’est un
poème de fin d’amour. « Chacun de mes poèmes est un événement
de ma vie, le plus souvent tristesse ».
-
1907-1912 :
Le temps de Montmartre et de Marie Laurencin (rencontrée
en mai 1907) : "Lul de Faltenein", "Le
brasier", la fin de « Fiançailles », "Poème
lu au mariage d’André Salmon", "Vendémiaire"...
Se
rapproche notamment en 1908 de Jules Romains et des unanimistes.
Puis en 1909 de Gide et de la NRF
L’organisation interne
Lorsqu’il composera son recueil, en
1911 & 1912, Apollinaire ne s’attache pas à suivre un ordre
chronologique. S’il conserve parfois des suites, il se plaît également
à brouiller les cartes, notamment en plaçant « Zone »
(à la dernière minute, sur épreuves, fin octobre 1912) en tête
du livre, ou en plaçant également au début du livre « Le
Pont Mirabeau » écrit en
1911. Les "Rhénanes" sont quant à elles dispersées dans
le volume.
Guillaume
Apollinaire organise son volume à partir de textes déjà publiés
en revue pour la plupart.
·
Récuse l’ordre thématique, l’ordre chronologique
·
Respecte une certaine alternance entre textes longs et
courts
·
Place une ouverture et un final très forts
·
Jeu entre un ordre et un désordre.
Le titre ?
Dès 1904, au moment où il publiait
en revue quelques poèmes, Guillaume Apollinaire annonçait le
projet d’une « plaquette à paraître : Le Vent du
Rhin ». C’est dire qu’il songe alors à faire éditer
l’ensemble des poèmes rhénans : ceux que lui a inspirés
son séjour en Allemagne et son amour malheureux pour la jeune
gouvernante anglaise Annie Playden. Il y ajoute en 1905 « La
chanson du mal aimé »
L’unité entre ces textes réside
pour l’essentiel dans leur tonalité mélancolique.
Son premier projet éditorial
n’ayant pas abouti, c’est en 1908 sous le titre Le Roman du
mal-aimé que Gustave Kahn annonce la réunion prochaine des
vers d'Apollinaire en volume, ce qui confirme bien la tonalité élégiaque
du recueil.
Mais en vérité l’inspiration d'Apollinaire
a changé à partir de 1907 avec la rencontre de Marie Laurencin qui
le conduit à quitter sa posture d’amant malheureux. Il se
rapproche alors de ses amis peintres, s’installe à Montmartre, et
compose des textes d’une inspiration nouvelle, plus dynamique et
dionysiaque
En 1910, c’est le titre "Eau
de vie" qui est retenu par Apollinaire et qui ne sera modifié
que sur les épreuves
En
quoi Alcools justifie-t-il son titre ?
-
références littérales à l’alcool et à l’ivresse
("Zone", "Vendémiaire")
-
évocation des tavernes, brasseries, auberges, caveaux
(Paris, Munich, Cologne…
-
évocation des vignes rhénanes
-
images poétiques : « Mon verre s’est brisé
comme un éclat de rire », « Mon verre est plein
d’un vin trembleur comme une flamme » les soirs de Paris
« ivre du gin flambant de l’électricité »
(que l’on opposera aux lueurs spectrales du gaz fin de
siècle).
-
Dans l’inspiration, Alcools peut évoquer la
soif, le désir de consommer
la vie. La
soif est synonyme de curiosité, d’enthousiasme, de désir
intense.
-
L’alcool éveille l’idée d’un excitant, de la
recherche d’un paroxysme = il faut se griser de la réalité
moderne.
-
C’est une figure dionysiaque de l’inspiration poétique.
La
soif du gosier lyrique
Le motif de la soif, de longue date
inhérent à la part dionysiaque de la lyrique, dramatiquement durci
par Rimbaud (« Comédies de la soif ») peut apparaître
comme l’une des illustrations du désir poétique : « J’ai
soif villes de France et d’Europe et du monde » s’exclame
Apollinaire dans « Vendémiaire ». « Ivre
d’avoir bu tout l’univers », le poète se figure lui-même
en « gosier de Paris », porte-voix et chanteur à
la fois. L
’ivresse dont il se réclame constitue l’une des manifestations
symboliques du principe amplificatoire qui est à l’œuvre dans le
lyrisme.
Alcool
et eau de vie
C’est ici l’occasion de rappeler
qu’avant de trouver, en octobre 1912, son titre définitif,
Apollinaire avait songé à
intituler son recueil « Eau de vie ». Bien que moins
« moderne » d’allure, le simple substantif pluriel
d’Alcools est à coup sûr plus riche de virtualités, plus
fort, plus résolu pourrait-on dire. Il se démarque en effet aussi
bien de « l’eau-de-vie » évoquée par Rimbaud
dans « bonne pensée du matin » que des multiples
ivresses évoquées par Baudelaire
dans Les Fleurs du mal ou Le Spleen de Paris. Alcools
résonne comme une désignation abrupte, délivrée des pathologies
morales dépressives qui avaient jusqu’alors accompagné aussi
bien les ivresses baudelairiennes que la verlainienne absinthe ou
les rimbaldiennes « taches de vin bleu » mêlées de
« vomissures ». Ainsi que l’exprime nettement la fin
de « Zone », l’alcool est assimilé par Apollinaire à
la vie même :
« Et tu bois cet alcool brûlant
comme ta vie
Ta vie que tu bois comme une eau
de vie »
Plus précisément, le motif de
l’alcool établit un parallélisme entre vie et poésie qui en lui
se confondent en une même intensité ou brûlure. Au dépressif
enivrement des buveurs d’absinthe et des fumeurs d’opium se
substitue l’idée d’une euphorique ivresse collective.
L’alcool d’Apollinaire n’est plus le baudelairien « vin
du solitaire ». Il rend plutôt possible une espèce d’ébriété
cosmique, une inflammation lyrique, la saoulerie des « chants
d’universelle ivrognerie. »
thèmes
et motifs :
L’écriture d’Apollinaire mêle
les motifs, le subjectif et l’objectif, le lyrique et le prosaïque :
modernisme, religion, amour malheureux…
-
La beauté du monde moderne (Tour Eiffel), la cité
industrielle, l’énergie de l’électricité, les lumières et
les émotions changeantes de la ville.
-
La poésie du quotidien : poser un regard neuf
sur les choses communes et y déceler une beauté.
-
L’ivresse de l’univers : célébration
d’une nouvelle énergie collective.
-
La mélancolie et
le passage du temps. Les saisons mentales. L’Automne.
-
La souffrance amoureuse
-
Les exilés de toutes espèces : émigrants,
matelots, prostituées, bohémiens. Les laissés pour compte de la
vie moderne.
-
La solitude dans la foule « maintenant je marche
dans Paris seul parmi la foule »
-
La figure incertaine du poète (ombre et passant)
-
La ville :
lieu ambigu, d’exaltation et de désespoir, d’émerveillement et
d’angoisse ou de désarroi. Apollinaire prolonge et radicalise
l’expérience baudelairienne.
Exemple
de texte 1 : « Le
voyageur »
Poème choisi pour faire
connaissance avec Apollinaire, en allant directement au vif, au
« moderne » de sa poétique.
Ce texte publié une première fois
(ponctué) dans « Les soirées de Paris » apparaît très
curieusement kaléidoscopique, tel un tissage d’éléments
disparates. Mais très vite il apparaît également que derrière la
discontinuité et l’empilement d’éléments hétérogènes se
jouent d’obsédantes reprises (« Te souviens-tu ? »).
Fernand Fleuret, à qui ce texte est
dédié, le définit comme une des « chansons farcies »,
des « complaintes populaires » qu’Apollinaire et lui
se plaisaient à composer.
Le motif : un homme frappe en
pleurant à la porte… de sa propre vie, à la porte du temps, de
la mémoire, du Grand secret…
Il s’agit d’une écriture de
l’incertitude d’exister dont le motif est livré par le deuxième
vers qui se trouve répété à la fin : L’Euripe est un bras
de mer qui sépare l’Eubée de l’Attique et où le courant
change jusqu’à 14 fois de sens en 24 heures…
Le lecteur est surpris notamment par
la multiplication des sujets : Je, tu, on, vous. De sorte que la
question de l’énonciation lyrique est posée de façon déroutante :
qui parle à qui… et de quoi ? Plus précisément, le texte
est traversé de figures à la fois précises et incertaines :
« Quelqu’un », « un autre », « deux
matelots », des « femmes sombres », « tous
les regards de tous les yeux », « les ombres »…
Le NOUS et le TU restent incertains, aussi bien que le ON.
Mais l’adresse est assez
insistante, le questionnement assez répétitif pour laisser
entendre l’un des enjeux pathétiques d’Alcools : la quête
de l’autre. Le dialogue ne s’installe pas : il est troublé :
les questions et les invocations restent sans réponse. L’univers
de références du texte est lui aussi incertain, très flou…
Cependant, les lecteurs érudits et
attentifs
ont pu observer dans cet apparent désordre nombre d’éléments
qui renvoient à des détails précis de la vie d’Apollinaire :
évocation de son voyage au Luxembourg, de sa vie au Vésinet, le détail
de la « chaîne de fer » (Apollinaire portait depuis son
enfance une chaîne ornée de médailles pieuses), le couple de
matelots habillés de bleu et de blanc comme Guillaume et son frère
portant des costumes marins…
Mélange donc d’autobiographie cachée,
de fiction, de chanson d’ivresse triste… Le souvenir y prend une
valeur « transindividuelle ». On pourrait presque parler
de « mondialisation » du moi. Apollinaire prend soin de
maintenir un flottement référentiel, énonciatif, qualitatif…
Ainsi les adjectifs ne cernent-ils pas le substantif auquel ils
s’appliquent (exemple « femmes sombres » :
tristes, liées à la nuit, prostituées, noires de peau, voilées
par l’obscurité du souvenir – ou « auberge triste »
ainsi qualifiée par hypallage, tout comme « troupeau plaintif
des paysages »…
Ces imprécisions favorisent le désancrage :
le sujet paraît se laisser emporter au fil de l’eau et du temps. ;
il est victime d’une déliaison mélancolique.
Le discours se conjugue ici avec le récit.
Ce discours est scandé par la reprise du verbe « se souvenir »
et notamment par la reprise anaphorique de la question « Te
souviens-tu ? »
Les vers eux-mêmes sont mêlés :
vers libres ou alexandrins, distribués en massifs inégaux. Eux
aussi sont pris dans ce processus de variabilité, plus réguliers
toutefois au moment où s’accomplit une espèce de descente parmi
les ombres (vers 32 à 47).
Apollinaire privilégie l’élasticité
métrique : 6, 8, 10, 12. Ce n’est pas véritablement le vers
libre qu’il recherche, ce n’est pas la libération du souffle
qu’il privilégie, mais le jeu entre régularité et irrégularité,
ordre et désordre.
Apollinaire joue notamment sur une hésitation
de lecture : si ces vers sont libres on n’en compte pas les e
muets, si ce sont des vers réguliers ceux-ci importent… Exemple :
« Nous traversâmes des villes qui tout le jour tournaient »
peut compter 12 syllabes (horizon métrique, mais au prix de deux
apocopes), ou 14 syllabes (horizon prosodique)… Apollinaire prend
plaisir à brouiller les pistes de la versification.
Ce travail d’estompe se retrouve au
plan de l’imaginaire sollicité par le texte. On y croise des chevaliers
barbus avec leurs lances qui évoquent le monde d’Avalon et des
romans de chevalerie. On y entend la plainte d’un sujet exclu
frappant à la porte close du Paradis, en un temps de
christianisme finissant… Comme dans « Zone »
l’errance se relie à la mort de Dieu qui semble affleurer au vers
13 : « Dans le fond de la salle il s’envolait un Christ ».
L’amour lui-même paraît
ici réduit à un jeu de hasard. : « L’on jouait aux
cartes / et toi tu m’avais oublié »
Dans les quatrains, c’est à Orphée
que l’on songe et à sa descente aux Enfers. Une parenté se tisse
phonétiquement entre ce motif d’Orphée et l’orphelin des vers
4 et 18.
Enfin, à la fin du texte, c’est en
« vieille abeille » que se métaphorise le poète.
Une abeille qui serait tombée dans le feu pour avoir voulu considérer
le passé de trop près…
Ainsi pourrait-on lire notamment ce
poème comme une allégorie de la condition humaine où sont
successivement évoqués l’enfance, l’âge mûr, les déceptions
de l’amour, la mort enfin…
Mais c’est plus sûrement une allégorie
du travail de l’écriture et de la mémoire : la page écrite
est le lieu où se déplie et se déploie la mémoire.
Enfin, je ne puis m’empêcher également
d’entendre dans ce texte une réécriture sombre du « bateau
ivre », allant du fleuve vers l’océan et se perdant dans
les profondeurs. Ici le bateau est un « paquebot orphelin »,
et ce n’est pas le solitaire et singulier voyage du « voyant »
qu’il évoque, mais celui d’une foule d’ombres pareilles aux réminiscences
du sujet…
|