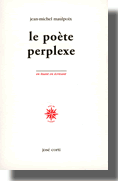Dans
les rues de la ville ...
Réflexions sur le sort
moderne de la poésie urbaine
par Jean-Michel
Maulpoix
Essai extrait
du volume "Le
poète perplexe", éd. José Corti,
2002.
Dans les
plis sinueux des vieilles capitales,
Où tout, même l’horreur, tourne aux
enchantements,
Je guette, obéissant à mes humeurs
fatales,
Des êtres singuliers, décrépits et
charmants
Charles Baudelaire
« Les petites vieilles ».
Dans une rue au coeur d’une ville de
rêve,
Ce sera comme quand on a déjà vécu:
Un instant à la fois très vague et très
aigu...
O ce soleil parmi la brume qui se lève!
Paul Verlaine,
« Kaléidoscope »
Dans une ville noire entraînée par le
temps
(toute maison d’avance au fil des jours
s’écroule)
je rentrais je sortais avec toutes mes
ombres.
Jean Tardieu, « Les jours ».
Dans les rues de la ville, il y a mon
amour. Peu importe où il va dans le
temps divisé. Il n’est plus mon amour,
chacun peut lui parler. Il ne se
souvient plus ; qui au juste l’aima ?
René Char « Allégeance ».
Je pourrais continuer ainsi à réciter ou à
inventer des vers qui tous commenceraient
par : Dans les rues de la ville... C’est
un refrain, une antienne, une scie déjà
par où la poésie moderne se plaît à
afficher sa sulfureuse, ambigüe et
coupable liaison — au sens propre contre
nature — avec le corps et
l’imaginaire urbains...
Dans les rues de la ville : c’est bien là,
en effet, qu’il rôde, qu’il va, qu’il
court, qu’il cherche, celui que Baudelaire
appelle « le peintre de la vie moderne »,
lancé dans le « grand désert d’hommes » à
la poursuite de « ce quelque chose qu’on
nous permettra d’appeler la modernité ».
Il
semble donc qu’avec ce très simple incipit
aux allures de rengaine « Dans les rues de
la ville... », l’espace de la modernité
s’ouvre en grand. La rue est la modernité
même, puisque le fugace sans cesse y
recroise l’histoire. La rue est l’espace
de lisibilité ou de perciptibilité (il
faudrait dire « percibilité » en inventant
un néologisme qui dirait ensemble la
percée et la perception) maximale de la
modernité. Hétérogène, mobile, aléatoire,
cinétique et cinématique... comme on
voudra.
Mais la magistrale proposition de
Baudelaire si souvent répétée a viré au
stéréotype. Elle est devenue truisme. Usée
à présent comme une vieille pièce de
monnaie... La ville est moderne : nous
avons compris!
Et puisque « la forme d’une ville / Change
plus vite hélas que le coeur d’un mortel »
(pour rester dans les citations
convenues), que reste-t-il aujourd’hui,
pour nous autres, contemporains vivant au
temps des mégapoles, des villes nouvelles
et des cités-dortoirs, oui que reste-t-il
des « plis sinueux des vieilles capitales
» dont Mallarmé naguère saluait
l’éclairage au gaz, « dispensateur moderne
de l’extase ». Quelle poésie urbaine
encore et moderne toujours qui ne recycle
pas d’anciens clichés ?
L’espace de Baudelaire n’est plus le
nôtre. Ou peut-être — protégés autant
qu’illusionnés par nos lectures —
l’avons-nous quitté sans vraiment nous en
rendre compte. Cela, la poésie, qui a
toujours un peu d’avance, le sait et le
vérifie aujourd’hui.
C’est ce que je voudrais rapidement
montrer ici.
En quittant la flânerie que suppose la
pluralité des rues (« Dans les rues de la
ville » : ce pluriel en soi était une
promesse...) pour quelque chose comme la
rue toute seule, la rue unique, roue ou
ruée, infinie glissade de la fin du siècle
Mais revenons quelques instants à
Baudelaire.
Si nombreux que soient sous sa plume les
balcons, les fenêtres et autres formes de
la verticalité, si tracassé qu’il soit par
l’Idéal et si désireux d’élévation, il
n’en reste pas moins celui qui a inauguré,
par ses errances parisiennes, en même
temps que l’horizontalité du face à face
avec les semblables, quantité de
trajectoires labyrintiques dans le commun
des mortels. Car telle est bien d’abord la
rue : un itinéraire horizontal parmi de
pierreuses masses verticales. Les rues,
c’est une multitude de tracés et de
trajets. De sorte que l’expression « dans
les rues de la ville » a quelque chose de
redondant ou de pléonastique : « la ville
est le corrélat de la route. Elle n’existe
qu’en fonction d’une circulation et de
circuits ». La ville est un système de
rues, une polarisation localisée de flux.
Là où naguère les pré-romantiques
traversaient les Alpes à pied et
s’exaltaient devant les cimes, le rôdeur
parisien se met en chasse dans un espace
qui en quelque sorte le rabat au sol, les
ailes collées à la poussière comme le
cygne. Le sens ne lui est plus donné — par
la Nature ou par les Dieux — il ne peut
être que poursuivi, interrogé, entraperçu
puis perdu au hasard des circonstances.
La ville est un un englobant autrement
aléatoire que la Nature. De même que la
modernité est autrement aléatoire que tout
classicisme. Ce temps paradoxal des
contradictions irrésolues ne suppose pas
de stabilisation de la pensée et des
formes, mais un parti tiré de la tension,
voire de la discorde ou de la discordance.
Peut-être ce chef-d’oeuvre de l’art
classique qu’est la Vénus de Milo est-il
passionnément moderne parce qu’il lui
manque des bras!
En modernité comme en ville, le rôdeur est
en proie à soi. En proie à l’humain désir,
à l’humaine faiblesse, à l’humaine
condition dont rien ne le protège. Aussi
la grande ville, souvent taxée
d’inhumanité, est-elle le lieu humain par
excellence : je veux dire cet espace que
l’histoire des hommes a construit et dans
lequel se joue leur présent, se cherche
leur présence. La pétrification d’une
géographie et d’une histoire, conjuguée à
la mobilité des modes, des trajets, de ce
qui s’appelle « l’air du temps ».
Accumulation de biens, de personnes, de
bruits et de signes la ville est un
accumulateur d’énergies : un discordant
concentré de langages. L’humain s’y livre
avant tout spectaculairement. Elle produit
constamment du langage par mélange et par
recoupement d’éléments hétérogènes. Les
machines à coudre sans cesse y croisent
les parapluies.
Ce milieu instable qu’est la rue est
favorable à toutes les métamorphoses, tous
les rapprochements, toutes les rencontres,
ces circonstances qui font la relation,
pour répéter le mot de Prigogine qu’aime à
citer Michel Deguy.
La cité moderne est par excellence le lieu
des équivalences, des convertibilités et
des réversibilités multiples :
solitude/multitude, victime/bourreau,
poète/prostituée, dégoût/fascination...
C’est un espace propice au jeu exacerbé de
la figuration, aussi bien qu’un spectacle
incessant de figures : mendiante, petite
vieille, mauvais vitrier ou coquette
indolente, espérance ou décrépitude, la
condition humaine s’y montre en figures
dont le poète accuse les traits et se
plaît à lever les masques.
En ce « parcours initiatique de la
solitude à la solitude à travers le
labyrinthe/multitude », l’unité ne peut
être ressaisie qu’à la faveur d’un
décrochement, dans la solitude de la
chambre, « à une heure du matin », par le
travail solitaire de l’art. Le « peintre
de la vie moderne » extrait nocturnement
de la ville ses archétypes, dans le
travail au noir de l’encre. Qu’il dresse
de cruels procès verbaux ou réclame de
l’idéalité, il développe en poème la
tension moderne de la rue, comme si
celle-ci était la corde même de son chant.
Or, ce schéma baudelairien a perdu de sa
force, en même temps que s’épuisait la
modernité et que la ville elle-même se
trouvait absorbée et défaite en mégapole,
réseau, banlieues : la combinatoire et
l’interconnexion y prenant le pas sur la
dialectique, la saturation des signaux et
la bousculade accélérée des corps y
occultant la lisibilité des signes et des
figures. Dans l’horizon contemporain, le
bavardage du village global recouvre les
bruits et les voix de la ville.
Indéfiniment distendue, elle ne donne plus
l’échelle ni le plan de l’humaine
condition.
***
Aussi la formule « Dans les rues de la
ville », si elle a pu évoquer un espace de
modernité peu ou prou aventureuse, tout
opposée aux paysages de la Nature,
est-elle à son tour devenue désuète. La
logique circulatoire contemporaine ne
passe plus forcément par là : elle tourne
plutôt autour de la ville, par-dessus ou
par-dessous. On y fait l’économie de la
rue et l’on accède directement du parking
souterrain au centre commercial. La rue
elle-même cède la place aux grands axes
véhiculaires ou aux cheminements obligés
et fonctionnels dans des espaces-types,
des espaces-prothèses : voie piétonne,
couloir cycliste, galerie marchande, avec
animations obligées, semaines commerciales
et vasques fleuries tout l’été de cascades
de géraniums roses à fleurs doubles....
Itinéraires chichiteux, où le flâneur ni
l’imprévisible n’ont plus leur place
puisque tout y est à la fois « mignon »,
convenu, préconçu, déjà vu et indéfiniment
reproductible ou transportable...
ailleurs. C’est le modèle « Decaux » de la
cité moderne...
Dans les rues de la ville, il y a le
mobilier urbain. La ville sort ses
meubles, montre ses meubles et vide ses
meubles, avec leurs soutiens-gorges de
top-models et leurs rafales d’informations
clignotantes.
« Dans les rues de la ville », disait-on.
Mais y a-t- il encore des rues quand ainsi
prolifèrent les « circuits intégrés » et
quand la ville elle-même se parcellise et
se sectorise, de moins en moins corps et
de plus en plus mosaïque, de moins en
moins un organisme et de plus en plus une
machine. Quand le ravalement excessif
dissimule les cicatrices de l’histoire et
blanchit tous les monuments, quand
l’architecture postmoderne fait de la «
fable » et de la forme des matériaux de
recyclage, transforme l’histoire en
citation, et mélange jusqu’au vertige ou
jusqu’au rien formel les époques...
Dans les rues de la ville, il y a les
excréments canins.
La passante d’aujourd’hui téléphone en
marchant. Elle porte sur les oreilles un
walkman.
La passante de naguère est devenue
touriste.
La rue appartient aux « rollerbladers » :
à ceux qui circulent et qui glissent, et
non à ceux qui cherche ce mystérieux
quelque chose qu’on appelle « la modernité
». Ceux qui roulent sur leurs patins ou
sur leur trotinette ne cherchent rien :
ils jouissent d’eux-mêmes. Voici que la
rue s’est changée en salle de jeux ou
terrain de sport...
On pourrait continuer ainsi...
« Dans les rues de la ville » : il y a
trop de lenteur et de romantisme tardif
dans cette expression, trop de flânerie
heureuse ou mélancolique. Trop d’état
d’âme pourrait-on dire. Trop d’élégie
latente. Voilà donc un motif à présent
nostalgique qui ne rend compte ni de notre
réalité ni de notre vitesse.
Certes, la rue approvisionne toujours (et
approvisionnera sans doute longtemps
encore) le poète en « choses vues »,
paysages, passantes, incongruités, émois
et sensations... Elle cadre toujours sa
vision et sollicite toujours ses pas. On
trouve encore ici et là dans Paris des
arpents de XIXème siècle, par exemple le
samedi soir sous les arcades du Palais
Royal, quand un castrat chante du Mozart
face à un groupe de femmes en manteau noir
et de messieurs en chapeaux...
Mais
ce n’est plus de ce pittoresque là que se
nourrit la poésie de notre temps. Ou
plutôt ce n’est plus par là que le
contemporain nous est lisible. Tout au
plus un Réda se laissera-t-il indéfiniment
dériver d’une rue et d’un quartier à
l’autre pour vérifier à chaque fois que «
ce qui se dévoile se dérobe aussitôt » et
que la ville d’aujourd’hui est en fuite,
en apnée dans le temps, en apesanteur dans
l’espace, illisible comme notre destinée,
mais sûrement pas allégorique, ni
réservoir d’allégories et de physiologies.
Là où le peintre de la vie moderne
transformait à sa guise « le boulevard en
intérieur » et se trouvait « chez lui
entre les façades des immeubles comme le
bourgeois entre ses quatre murs », le
baguenaudeur post-moderne se montre
radicalement déconcerté : il ne peut faire
centre nulle part, et la ville le renvoie
toujours vers ses marges comme un boxeur
dans ses cordes. Partout de la périphérie,
rien que de la périphérie, tout est
périphérique. La tourne est infinie; elle
dure tout le temps de la vie d’un homme.
Pas de sens donc, mais des zigzags, pas
d’allégorie mais des timbres-poste. «
Circulez, il n’y a rien à voir » : voilà
le mot de la fin.
La phrase par laquelle le peintre de la
vie moderne parvenait à extraire « la
fantasmagorie de la nature » et à
idéaliser les matérieux divers ramassés
lors de ses courses parisiennes, a éclaté.
La magie est perdue de la perception
ingénue et magique. La rue a volé en
morceaux! La rue et son résumé symbolique.
Le tout n’est plus en vue. Nous en avons
fini avec les Correspondances.
Chez Michel Deguy,
les « sorties » continuent de se
multiplier. Mais les « arrêts fréquents »
(titre d’un livre publié en 1990, aussi
bien que mention figurant à l’arrière des
camionettes jaunes de La Poste) ne sont
pas ici ceux du flâneur. Ils viennent
plutôt interroger le culturel, la culture
MacDo, la culture des MacDo où se pressent
les familles comme naguère à la Messe, ce
que Deguy appelle « le religieux
contemporain ».
Le culturel, c’est la résultante de
l’addition contemporaine de la technique,
du commerce et du spectacle. Il occupe la
scène à lui seul. Il fait scène dans la
rue, laquelle y perd son latin et y perd
sa « modernité » : on n’y trouvera plus le
poétique de l’historique qui est la mode,
on n’y extraira plus l’éternel du
transitoire, on y assistera à la mise en
scène d’éternités transitoires. La rue
contemporaine propose du religieux à
consommer sur place. A chacun sa grande
Messe (finale de coupe d’Europe ou de
coupe du monde)...
Si Paris donne encore son nom-titre à
l’une des sections d’Arrêts fréquents,
c’est par exemple pour considérer ceci :
Les sous-titres analphabeto
Font de la traduction en désesperanto
Burger Burgerking et Macdo
C’est le bastringue de la nuit Rétro
Depuis la ville, ou dans la ville, le
poète regarde le temps de la planète. « Le
monde repasse partout ». La rue est
devenue chantier. Elle n’est plus
fréquentable ni directement lisible, mais
« saturée, gribouillée, pulvérulente,
d’une intense et folle ébulition de
trajectoires individuelles et
microsociales ».
La rue n’est plus la rue où l’on flâne,
pas même celle où l’on rôde. Baudelaire et
Apollinaire sont loin. La voici plutôt, la
rue cinématographique américaine de Deguy:
dans la rue, la rue cette boule magique,
ce miroir convexe, ce concentré de la
ville, la rue pornocrime, la rue
droguéifliquée, le ru, le rut, la ruée, la
corruption mainstreet dévastée... (non,
non, je n’exagère pas, allez au
cinéma...); or c’est là que désirent
vivre, qu’affluent de toutes parts « les
gens », leur désir (le nôtre) d’être
créatures de film, médiatiqués
Dans l’oeil et sous la plume de Deguy, le poème
devient poléoscope : un «
observatoire des cités ». La ville s’y
dilate. La ville y dilate sa pupille. Elle
n’en croit pas ses yeux.
Le poète reçoit moins d’influx de la ville
que de stupeur. Il en vient moins
répercuter les énergies qu’interroger les
aberrations. Les rues contemporaines sont
des apories.
La rue du commun-des-mortels, la rue de
l’espèce humaine, n’est pas faite pour la
flânerie, mais pour la pensée.
Deguy relaie Baudelaire, mais en
l’intensifiant. Importent cette fois les
parcours retracés et la « tropologie » du
dire. Seul à même de faire face, en son
effort de langue à cet espèce de trou
qu’est devenu la rue
Ce à la recherche de quoi erre le poème
d’aujourd’hui, ce n’est ni d’un lieu ni
d’un être. Il ne compte plus sur la
rencontre. Il ne cherche plus la passante.
Il cherche plutôt à voir sa langue dans
l’éclairage des choses. Il vient éprouver
les limites de sa compréhension.
Dis-moi quelle est ton errance et je te
dirai qui tu es, tel pourrait être le fin
mot de ces trajectoires répétées :
L’errance « spatiale », dont je puis
parler, l’accueillant aveuglément en mon
quiproco, attend que j’apprenne quelle
est mon errance.
Errance est le nom de cette ignorance qui
cherche et qui attend. Peut-être de
devenir poème.