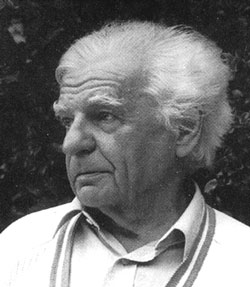|
par Jean-Michel Maulpoix
En même temps qu’un nouveau livre de poèmes, Les Planches courbes,
Yves Bonnefoy publie plusieurs plaquettes où ses réflexions se
ramifient. Entre ces différents ouvrages, qui entretiennent un
singulier dialogue, il est un point commun : le poète s’y retourne
vers le passé. Nombre de ses textes sont à l’imparfait. Ils réveillent
des images enfouies que l’on pourrait croire nostalgiques. Mais c’est
le vif de la présence et de l’espoir que recreuse ici le travail rêveur
de la mémoire.
YVES BONNEFOY
LES PLANCHES COURBES, Mercure de France éd, 144p., 82F — 12,5 e
LE THÉÂTRE DES ENFANTS, William Blake &
Co, éd, 56p., 70F — 10,67e
POÉSIE ET ARCHITECTURE, William Blake &
Co. éd., 48p., 68F — 10,30 e
LE CŒUR-ESPACE (1945, 1961), Farrago éd., 64p., 90F —13,70 e
BRETON À L’AVANT DE SOI, Farrago éd., 128p., 90F —13,72 e
Rauques étaient les voix
Des rainettes le soir,
Là où l’eau du bassin, coulant sans bruit,
Brillait dans l’herbe.
Le premier poème des Planches courbes donne, si l’on peut dire, le ton de cette lointaine voix de
mémoire
qu’il réveille. Nul « je », tout d’abord, mais une simple sensation
sonore, issue d’une enfance perdue aux images restées vives, et grâce à
laquelle, bientôt, un « nous » va se recomposer. Au plus près de ce
murmure d’ombre, la vision se fait clair-obscur : le poète projette sur
les empreintes d’autrefois les rayons obliques d’une heure
crépusculaire. A moins que ce ne soit la clarté même, iridescente, du
passé heureux qui soudain se faufile et s’impose à lui dans la pénombre
affaiblie du présent, apportant avec elle la remémoration d’un âge
ancien qui fut de proximité, de familiarité avec les lointains : un
temps où paraissait possible, et quelquefois même évidente, au gré d’un
miroir d’eau par exemple, la réversibilité du ciel et de la terre, un
temps où « tout était pauvre, nu, transfigurable », où la présence, qui
est l’or du temps, semblait offerte et se laissait cueillir comme une «
grappe rouge ».
« Il
marchait dans les bois quand il entendit ces rires, ces exclamations,
cette joie. Et que faire alors sinon s’arrêter, le cœur battant,
écouter la voix des enfants à travers le rideau des branches puis se
risquer vers eux, l’autre monde ? »
Ainsi s’ouvre, dans la même pénombre étrange, Le Théâtre des Enfants.
Encore une fois, il s’agit de redessiner et d’interroger une enfance,
comme de répéter les trouées qu’elle fait encore en nous. Ou d’obéir
tout simplement à cet écho, ce « chant de rien » qui insiste et qui
réclame.
Ainsi, d’un livre, d’un texte à l’autre, paraît se répéter le même geste, tel une métaphore de l’écriture même :
marcher,
« rouler plus loin », s’arrêter en chemin, surpris par une image ou par
des voix inattendues, écarter les branches, essayer d’entrevoir et
d’entendre. Répondre à des appels derrière des rideaux d’arbres. Dans
l’encre, des visions phosphorent un peu — à peine quelques flocons —
jetant des clartés, éclairant des noms, désenchevêtrant leur énigme.
Elles font se réveiller le temps.
« La pluie d’été », première partie des Planches courbes,
est à la fois chemin et succession de stations : un déplacement ponctué
d’arrêts, de « pierres écrites », méditations et inscriptions, stèles
aussi bien que tables d’écriture où se dépose et s’examine cela, cet
appel, cette « hâte mystérieuse », cette évidence imminente d’une voix,
d’une vie longtemps rêvée… Il y a toujours, dans l’univers d’Yves
Bonnefoy, des arbres, de l’eau et des pierres : ce qui s’élève, ce qui
s’écoule, ce qui s’immobilise.
Ce n’est donc pas avec mélancolie que le poète se
retourne.
Plutôt pour sentir affluer en lui des images rêveuses où le sentiment
de la présence s’observe et se recreuse. L’écriture poétique cherche à
voir « dans les choses d’ici le lieu perdu ». Ses mots, ses images, ses
vers, palpent aveuglément les murs d’une « maison natale » qui est en
définitive moins celle où l’on a réellement vécu que celle dont on
transporte en soi, comme un précieux viatique, les odeurs et les
chambres. Une maison qui serait comme un navire, où s’endormir
l’oreille collée contre le bois. Maison de mémoire ou maison de langue,
laissant encore une fois venir, mais dans la brillance d’une poignance
tout autre, ce qui naguère nous fut donné aveuglément :
Le
poème est la barque du passeur. Il traverse le rien, il cherche un
rivage, noue une ombre à une illusion, mais sait avec exactitude quel
poids d’espérance et de chair est une existence. Et cette barque,
n’est-ce pas le ciel même qu’elle paraît franchir, lorsque celui-ci se
reflète sur la rivière et se voit poussé par la rame ? Ce ciel, qui est
l’inaccessible, où les hommes ont logé « le sans nom », « ce qu’ils
appellent Dieu », le voici à portée du regard et de la main, comme
tombé en flocons sur le monde, parmi toutes ces choses qui y brillent
un peu : des graines, des herbes sèches, ou ce broc d’eau claire « posé
sur les dalles sonores »…
Puisque « nous sommes des
navires lourds de nous-mêmes, débordant de choses fermées », c’est «
dans le leurre des mots » que s’en va cette avancée aveugle de la
langue qui fraie son sens en frottant de la transparence contre de
l’opacité. Comme si la poésie s’alimentait conjointement à deux sources
apparemment contradictoires : la bouche d’ombre de l’inconscient et «
la vie quotidienne de la lumière ». Peut-être est-ce là d’ailleurs ce
qui identifie le mieux la poétique d’Yves Bonnefoy : cette proximité de
la présence et du songe, de l’élémentaire et du lointain, de l’évidence
sensible et de l’inconnu. Là s’établit son rapport critique à l’image,
aussi bien que la fonction heuristique de celle-ci. Là se détermine le
rythme même de son phrasé, oscillant entre vers et prose.
Republiant, aux éditions Farrago, Le Cœur-espace,
son premier vrai poème (dans ses deux versions de 1945 et de 1961),
Yves Bonnefoy nous rappelle quelle influence eut le surréalisme sur ses
débuts et combien s’y ouvrit pour lui la possibilité d’une rupture et
d’un seuil nouveau du langage où pouvait s’exprimer « la parole de
l’inconscient ». Mais ce n’est encore, dans cette « écriture
automatique », livrée toute à l’afflux des images, qu’un moment
inaugural et pré-critique où étincellent des entrevisions « qui
n’atteignent pas à la véritable poésie » qui est « une prise de
responsabilité » et qui suppose la mise en vigueur d’un « principe d’examen ». Cette descente dans l’obscurité verbale de l’intériorité s’est poursuivie de livre en livre jusqu’aux Planches courbes,
moins impensée que critique cette fois, écoutant, scrutant et
déchiffrant cela dont la poésie fut tout d’abord l’enivrement. Pas à
pas, le nautonier est passé de la proue à la poupe.
Il serait donc
simpliste de ne voir en Yves Bonnefoy qu’un poète ayant rompu avec le
surréalisme de ses débuts. L’hommage qu’il rend à la figure de proue de
ce mouvement dans Breton à l’avant de soi en
porte témoignage : le surréalisme fut la revendication impatiente, non
pas seulement d’un absolu chimérique, mais d’une présence plus vive au
monde, d’une lecture plus pénétrante du réel, d’une énergie et d’un
désir, navire encore tirant sur l’amarre et réclamant de se
désenchaîner…
Si solidaires les uns des autres sont
les travaux poétiques et critiques d’Yves Bonnefoy, si attachés à la
reprise insistante des mêmes questions et des mêmes motifs intéressant
toujours la jointure de l’existence au poème, que l’image des «
planches courbes » se trouve à nouveau étonnamment illustrée dans un
petit opuscule intitulé Poésie et architecture
où se voit imprimé le texte d’un discours prononcé à l’Université Rome
III le 24 janvier 2001. Là, le poète ne développe pas de métaphore
maritime, mais, comparant l’architecture romaine de l’Antiquité à celle
de la Renaissance, en vient à définir la poésie comme « la voûte dans
l’écriture », c’est-à-dire cet espèce de miracle de la gravité par
lequel « le mur qui s’élève pierre après pierre se fait comme conscient
du voisinage d’un autre mur et se penche vers lui, risque son équilibre
dans le vide qui les sépare, défie la gravitation, mais reçoit alors le
secours du côté opposé de l’édifice, qui semblablement s’est porté en
avant, les deux murs ensemble faisant naître alors un espace, au sein
duquel on peut vivre. »
Belle image que celle-là , pour dire
ensemble le risque et l’ajointement, le vertige et la proximité : la
poésie, « ce sont des vies qui se rapprochent les unes des autres en
cet instant même où elles retrouvent chacune leur réalité infinie ». Ce
sont donc encore des planches courbes, mais dressées cette fois. Abri,
mémoire et promesse à la fois.
Qu’il compose des poèmes, des « récits en rêve » ou des travaux
critiques, Yves Bonnefoy pose obstinément les mêmes questions qui sont
ses chemins traversiers. N’est réelle pour lui « que la voix qui espère
». Ainsi travaille-t-il au maintien du poème,
de la forme et de l’ouvrage poème. Aussi poignante que l’obscure
mémoire qu’elle réveille est sa voix propre, qui volontiers invoque ou
interpelle, précaire, semblant parfois tout près de se taire comme de
prier, afin de retenir ou sauver ce qui s’enfuit, mais ne cessant à
chaque fois de vérifier et de réapprendre à accepter la finitude. La
tâche du poète n’est-elle après tout de nous donner à aimer cette terre
provisoire et fragile et d’apaiser les feux de notre condition mortelle
(en nous entretenant à la fois de l’évidence et du mystère, en croisant
la beauté avec l’irrémédiable) ? Plutôt que s’écrier « que partout sur
terre injustice et malheur ravagent le sens », plutôt que « disloquer
la parole » et « n’être que la lucidité qui désespère », il lui
appartient d’articuler, de nommer, et ainsi de chercher encore une
issue à ce que Mallarmé appelait « le tunnel de l’époque ».
Cette étude, plus développée,
figure dans Adieux
au poème de Jean-Michel Maulpoix

|