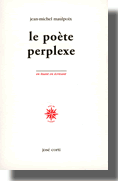La poésie
touche à sa fin. Elle s’achève à présent.
Peut-être
n’y aura-t-il bientôt plus rien à écrire.
Peu soucieux « d’extravaguer du corps »,
les contemporains renoncent à se mesurer à
l’impossible avec des mots. Aussi bien que
dans la marchandise, ils trouvent dans la stupéfaction
leur content. Bousculés dans le tohu-bohu des
villes, roulés dans la farine des images, ayant
jeté l’éponge, ils ne cherchent plus guère
à reprendre pied sur la terre dont ils se sont
eux-mêmes exclus.
****
Ceci
est un livre d’adieux à ce qui se perd
ou qui a déjà disparu : le poème,
tissage de figures, objet de beauté, densité
de faits de langue, respiration accélérée ou
très lente de la pensée. Évidence et
perplexité.
La poésie
sur sa fin se retourne mélancoliquement vers
les voix chères qui se sont tues. Le poème,
tel que nous l’avons aimé, dit-elle, est un
objet perdu.
Dire
adieu : c’est signifier pourtant que
quelque chose doit encore être écrit… En
souvenir du poème. Comme on viendrait
entretenir sa tombe pour en garder mémoire. Ou
construire sa dernière demeure : une
simple boîte clouée. « Le minuscule
tombeau, certes, de l’âme . »
****
La poésie
française de ce temps s’est nourrie, jusqu’à
l’étouffement, de tout ce qui mine, empêche
et paralyse le chant. Ayant pris acte du désastre,
elle n’en finit plus de répéter la fracture,
le défaut et l’évidement. À de rares
exceptions près, elle ne sait ou ne peut plus
rien dire de nos appuis possibles, nos raisons
de vivre ou nos biens. Incapable de porter
secours, de prêter main forte, il ne semble pas
qu’elle puisse s’opposer à l’Époque
autrement qu’en se désavouant elle-même.
Aggraver le réel, durcir le trait, surcharger
de noirceur le propos, telles sont désormais,
chez nombre de contemporains, les seules réponses
possibles.
Étrangère,
hostile à ses anciens rêves, fatiguée de son
impuissance, honteuse de ce qu’est devenu le
monde, la poésie voudrait en finir avec
sa propre histoire.
****
Voilà
bien des années pourtant que les modernes
s’efforcent de blanchir le poème de
ses fautes en le délivrant de la musique et des
images. Amaigri, appauvri, interdit de Chant, le
voici devenu un rude et sobre objet de langue,
moins fait pour émouvoir ou séduire que pour
infuser de l’effroi. Le discours en vigueur ne
tolère la poésie qu’à la condition
qu’elle se déclare « inadmissible » :
coupable d’imposture, elle ne sera lavée de
ses crimes romantiques qu’en se livrant à la
plus sévère des autocritiques.
Les
poètes, pourtant, ne sont ni des enfants
prodigues ni d’incorrigibles rêveurs. Ils ne
confondent pas les masques et les visages. Si
stupéfiantes soient-elles, les images qu’ils
inventent consistent en des « fautes
calculées »
ayant l’indécision et le vacillement du
sensible pour objet.
****
À
force d’affirmer son autosuffisance et de
s’examiner au miroir, la poésie ne voit plus
qu’elle-même. Paralysée par le soupçon,
elle ne chante plus, ne s’offre plus, mais se
retourne contre ses anciennes raisons d’être :
le souci, la beauté, l’espérance, l’amour
de ce monde… Elle ne trouve que leurres et
mensonges dans ce qui lui fut une valeur. Elle
n’est plus même cette vigoureuse puissance
d’examen, encore toute mêlée de célébration,
qu’illustrèrent Baudelaire
, Rimbaud
ou
Mallarmé
: rien que le terme amer d’une condition
déchue.
****
Que
faire à présent de la longue liste de vertus
et de devoirs naguère déclinés par Victor
Hugo
dans
sa préface aux Voix intérieures ?
Ne sont-ils que le désuet témoignage d’une
époque oubliée et d’une mission perdue ?
Entre l’exagération romantique de la valeur
et l’aggravation contemporaine du non-sens,
n’y a-t-il aucune place pour quelque « pensée
grave, paisible et sereine » dont le poète
aurait encore la charge ?
Souvent
me reviennent en mémoire ces mots inattendus
d’Henri Michaux
: « – je dois donner confiance,
donner courage. »
****
Nous
avons depuis longtemps reconnu que « tout
fait signe de se taire ! »
Que les langues sont « plusieurs »,
que les mots ne sont pas les choses, que dans la
parole nous sommes en exil, que les images sont
trompeuses, que les idées ne constituent pas un
monde où vivre, et que le lyrisme fait le lit
de son propre échec… Tout cela, qui fut tant
répété, décliné depuis plus d’un siècle
sur tous les tons, comme une espèce de sombre révélation
aux conséquences incalculables, est à présent
devenu un truisme. Comme est également rabâchée
l’idée que « nous ne sommes pas au
monde »
et que notre « part maudite » trouve
dans le poème à se dire… Mal équipés pour
l’ici-bas, insatisfaits et désireux, nous
sommes tous doués d’un manque !
Ce défaut
est pourtant notre bien le plus précieux. Loin
de nous y attarder tristement comme sur la
marque indélébile de notre incomplétude et de
notre impuissance, il s’agit de l’accepter
enfin sans amertume : le négatif ne
nous prive pas du chant, il nous en révèle
plutôt la beauté. Si la raison d’être des
choses demeure hors de notre portée et si le réel
reste impénétrable, alors nous sommes le poème
de ce mutisme !
****
Pour
plaire au goût français, il faut cacher
presque la poésie, comme on fait pour les
pilules, dans une poudre incolore et la lui
faire avaler sans qu’il s’en doute.
En
France, le grand ennemi, encore et toujours,
reste la puissance d’enchantement du lyrisme.
Sa faculté d’exagération, son appétit pour
le sublime, son acharnement à vouloir
l’impossible, aussi bien que ses fièvres et
ses croyances soudaines… On n’aime guère
les voix chaudes aux accents émouvants !
On leur préfère une prose très blanche,
d’une tenue froide et grammairienne, et ce
trait sarcastique qui tient l’autre à
distance.
…
Nous n’en sommes pourtant plus là. Il serait
temps de renouer avec l’étendue des
potentialités d’un langage dont les
insuffisances et les pièges ont été explorés
en tous sens.
****
–
Dites, les mots souffrent-ils ? demande
Virginia Woolf
. Mais
de quoi souffriraient-ils ? Sinon de
l’oubli de leur fragilité et leur éclat ?
Passant de bouche en bouche, ou de bouche en
oreille, sans qu’il leur soit prêté beaucoup
plus d’attention qu’à de simples bruits.
Devenus choses communes, ou vieille monnaie usée,
sans aucune mémoire de ce vide qu’il leur
appartint de creuser dans la tête de l’homme.
Est-ce au poète de leur prodiguer ses soins, ou de les
faire souffrir davantage ?
****
De
qui le poète conservera-t-il une chance de se
faire entendre, si sa plume ne se montre
accueillante qu’à l’irrégularité et au
malaise ? Doit-il considérer que sa place
est à jamais perdue, sa fonction vidée
de sens : coupé de tout public, il n’écrirait
que pour des pairs qui ne le lisent pas, autant
dire pour rien ni personne, prisonnier d’une
stérile manie…
Ne
peut-il être que violent, moqueur et désespéré :
iconoclaste témoin de la fin d’un monde
qu’il aurait tout à fait renoncé à rendre
plus lisible ?
Difficile
après Rimbaud, Lautréamont,
Bataille,
Beckett
ou
Artaud, de
faire entendre encore la voix qui espère.
Depuis que l’écriture a su faire face au Mal
et à l’informe pour les dire avec force, il
semble que seule la voie du négatif lui demeure
ouverte, et qu’elle ne puisse combattre les
laideurs de l’Époque qu’en les répétant
violemment…
Il
est un fait, pourtant, qui affaiblit la force
subversive de semblables démarches : leur
actuelle récupération cynique et frivole par
la société du spectacle et du marché. Rien
n’est plus à la mode aujourd’hui,
dans la littérature comme dans les arts, que la
transgression : « l’impératif
pornographique » fait prospérer le
commerce du papier et des images. Comme
l’observe Jean Clair
dans
De Immundo, « tout un establishment
du goût paraît applaudir cet art de
l’abjection. »
Rien de plus banalisé sur les écrans
cathodiques que la violence chic ou trash.
Rien de plus rare que la beauté…
Ne
se pourrait-il à présent que, par un
incroyable retournement, l’irrégulier et le
bizarre, l’inouï et l’inadmissible, ce ne
soit plus le négatif mais son contraire ?
Non pas l’excès, mais la mesure. Non
l’insensé, mais le désir de sens.
****
La
poésie néanmoins
La poésie
existe de se situer et se réévaluer sans cesse
contre ce qui la menace, la mine ou l’empêche.
Je ne peux donc me résigner à lui assigner
comme unique objet de mesurer « l’étendue
du désastre », non plus que de répéter
jusqu’à plus soif son inutilité.
Propriété
de la poésie moderne : intégrer la
critique de ses limites et la conscience de son
échec. Identifier le rien à partir
duquel il faut recommencer.
Il ne
s’agit donc plus de redire la nécessité
d’en rabattre. Chercher plutôt comment
poursuivre ce « jeu insensé » :
À quoi bon ? Jusqu’où ? Avec
quelles forces ?
Poésie :
piqûres de rappel contre l’oubli, contre
l’usage, contre l’usure.
****
Sauver
l’idée de poésie : la confiance
en une respiration possible dans le langage. Ni
docile instrument de « communication »,
ni marque fatale de notre étrangeté. Lieu plutôt
d’un travail où les mots parfois
recommencent à ressembler aux choses, où des
liens se renouent et des formes s’inventent
pour nos manques les plus inconsolables.
Nous
savons qu’elle parle de ce qui déclenche ou
coupe la parole : les émotions, les
angoisses, le passage silencieux de la beauté.
Elle défait déforme, dérègle et multiplie
les significations. Ainsi consiste-t-elle en une
suractivité de sens qui vient répondre à
l’absence initiale ou à la pétrification du
sens.
Tout
poème véritable embrasse dans le même
mouvement sa vocation au silence et ses recours
contre ce silence.
****
À la
question souvent posée : « comment
écrire après Auschwitz ? », je
continue d’entendre la réponse apportée par
Edmond Jabès
:
Mes
chants ont la friabilité des os sous la terre.
J’ai célébré autrefois la sève et le
fruit. J’accordais peu d’importance au vent.
Le
ciel ferré de l’automne est notre lourd
firmament.[9]
Cette
réponse prend la forme d’une brève poétique
qui vient confirmer le mot de Paul Celan
: « Il y a encore des chants à chanter
au-delà des hommes. »
Ces chants ne sont plus de célébration, ni
d’élévation, puisque le ciel est « ferré »
comme les lourdes bottes des militaires. Il ne
s’agit plus de chanter la croissance et la
fructification, mais de considérer
l’invisible, qu’il soit celui d’un souffle
ou d’une mémoire enfouie. Marquer sa fidélité,
en une parole discontinue et fragmentaire, à ce
qui a été et qui a disparu. Prendre soin de la
finitude comme on prend soin des morts. En
veiller la trace, en entretenir la mémoire.
Demeurer le présent souci d’une souffrance
passée. « Il faut écrire à partir
d’Auschwitz, de cette blessure sans cesse
ravivée. »
****
Reste
un désir désespéré : faire revenir ce
qui s’éloigne, remettre en circulation et en
débat les deux grands motifs dont toute la
modernité poétique a depuis Baudelaire
vérifié
inexorablement le déclin : l’espérance
et la beauté. Ce sont deux mots perdus,
deux vieilles lunes hors de propos dont il est
à présent jugé inconséquent de parler…
Comme de la responsabilité du poète en
un temps où l’audience de sa voix est réduite
à très peu.
J’appelle
pourtant « poète » – et ce mot,
bien évidemment, résonne comme un anachronisme
– celui qui ne peut,
ayant mesuré l’étendue du désastre,
échapper par sa parole au devoir d’espérance.
Celui dont le langage descend profond dans
l’obscurité où fermente « un million
d’helminthes »,
mais veut encore par-dessus tout « saluer
la beauté ».
****
La
langue de poésie ne se laisse enfermer en
aucune catégorie, ne peut se résumer par
aucune démonstration. Ni instrument, ni
ornement, elle scrute une parole qui charrie les
âges et l’espace fuyant, fondatrice de
pierres et d’histoire, lieu d’accueil de
leur poussière. Elle se meut à même l’énergie
qui fait les empires et les perd.
L’histoire
de la poésie du passé, en ses heures les plus
lumineuses, rappelle à nos temps de détresse
combien il reste dans la nature de cet art de
s’attacher passionnément aux traces de la
beauté. Il n’est pas de prétention plus
catastrophique que celle qui entend balayer
cette mémoire et congédier une fois pour
toutes la quantité de rêverie et de désir que
la poésie a toujours porté en elle.
Si démuni
et soupçonneux que soit le poète
d’aujourd’hui, il lui appartient de
continuer de prêter l’oreille aux « chants
de la plénitude » recueillis dans les
livres du passé. S’il ne peut en composer de
semblables, au moins les recevra-t-il comme des
lueurs lointaines venant éclairer sa nuit.
****
Dire
ensemble, au plus près l’un de l’autre, ce
qui nous tient en vie et ce qui nous dépossède :
lier le vivre et le mourir en une même gerbe de
mots. La poésie est ce travail du langage qui
illustre notre capacité à articuler
notre finitude dans le temps qui est le nôtre.
Si
elle appelle souvent à ses côtés la note, le
fragment, ou l’essai, c’est qu’il lui faut
sans cesse réajuster son propos à des objets
qui se dérobent.
Poésie :
les enjeux et les formes de notre destin
dans la langue. Pas d’autre vie, pas d’autre
monde : c’est sur cette terre que ça
se passe !
****
Ne
pas laisser la réflexion sur la poésie se
refermer jalousement sur elle-même, mais
percevoir dans le poème le noyau ou le cœur
loquace et très riche de notre vie langagière.
L’interroger donc attentivement, pour approcher
le problème d’être. C’est alors que
s’avère son importance, et cruciale, en un
temps où il ne peut plus se contenter de jouir
mélodieusement du langage et de l’apparence
des choses.
Reste
le souci de dire avec force, justesse, éclat,
brio parfois. Une parole qui y verrait clair,
jusque tard dans la nuit.
Reste
l’effort de dire encore ce qu’est ceci,
cela… le saisir en propre… le donner à
percevoir… à voir d’une façon plus perçante…
Dire à
quoi ça ressemble… Plutôt que de subir
la vie ne ressemblant à rien.
****
J’appelle
monde ce qui est autour, au loin, tout près,
là-bas, dehors ou au-dedans, le tout de ce qui
existe pour nous, à échelle humaine, et dont
je puis parler. En ce monde, notre monde, sont
des choses qui demeurent et d’autres qui ne
cessent de changer, la nature et l’Époque, du
connu, de l’inconnu et de l’inconnaissable,
tout cela enveloppé dans une immense question
à laquelle nul effort humain ne saurait
apporter de réponse. Ainsi le monde est-il
aussi bien notre prison que l’étendue de nos
ressources et de nos pouvoirs : il assure
davantage que notre subsistance, dans les
limites qui nous sont imparties…
Que
fait la poésie, si ce n’est poursuivre à
travers les âges l’entretien palpitant, et
comme respiratoire, de la créature avec ce
monde ? Notre façon tout à la fois
d’interroger sans relâche et de répondre présent.
De s’inquiéter, de s’attacher, de considérer
ce qui arrive, perdure ou se défait. De garder
l’œil ouvert.
****
À la
poésie de nous conduire, non de la nuit à la
lumière, mais de la déploration de
l’obscurité à la possibilité d’aimer
la lumière.
Il ne
s’agit de faire entendre ni la voix simple de
la terre confiée aux oiseaux ou aux vents, ni
celle des dieux perdus ou des anges, mais
l’effort et le désir proprement humain de
dire ce dont une existence est faite, si errante
et si désarmée soit-elle.
(Tous droits réservés, éd. José Corti).