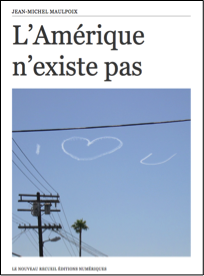|
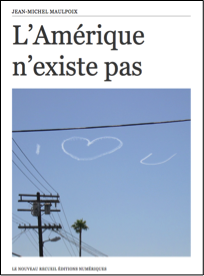
|
L'Amérique n'existe pas
Premières impressions d'Amérique
Texte et photographies de Jean-Michel Maulpoix
Extraits d'un carnet de voyage à Los Angeles
Texte intégral disponible sur Apple store, Kobo et Amazon en téléchargement. Prix moyen 5 euros.
|
22h
30. Descente vers Los Angeles. L'avion va se poser dans une plantation
d'arbres de Noël, une immense boîte à bijoux, un horizon de cinéma, une
collection complète d'étoiles. L'Amérique jette ses feux : des
centaines de kilomètres carrés de lumières scintillantes, des milliards
d'ampoules, des millions de vies inconnues à 100 watts montées en têtes
d'épingles. L'Amérique est une gigantesque facture d'électricité. Son
grand show commence dans le ciel. Juste avant de toucher le sol, me
saute aux yeux ce rêve que je suis venu chercher.
Autour
de la piste d'atterrissage, ce ne sont pourtant que des constructions
basses, d'une architecture médiocre. Puis, dans les couloirs de
l'aéroport, des aménagements vieillots et des peintures défraîchies. Je
m'attendais à plus de luxe.
Longue
file d'attente au contrôle des passeports. L'Amérique se mérite : après
onze heures d'avion, il convient de vous montrer encore capable de
patience. La socialité en surplus. Chacun son tour : ici, on ne triche
pas, on ne se bouscule pas. Ce pays ne saurait tolérer l'étranger que
vous êtes qu'à l'unique condition qu'il respecte scrupuleusement
chacune de ses règlementations. Vous venez ici pour vos affaires ou vos
loisirs : vous allez en profiter pour réapprendre la discipline.
Pas de comité
d'accueil plus impressionnant que celui qui attend les passagers des
vols internationaux à l'arrivée de LAX. Une fois les formalités
douanières accomplies et ses bagages récupérés, le nouveau venu remonte
un tunnel pentu et émerge, comme d'une bouche de métro, au milieu de la
salle d'attente noire de monde : une foule énorme est agglutinée contre
la rambarde qui la sépare des voyageurs. Elle se tient penchée là comme
sur un belvédère pour considérer les visiteurs du ciel arrivant par en
bas. La sortie a des allures de triomphe : vous avez franchi
l'Atlantique, c'est l'Amérique qui vous reçoit. Des gens de toutes les
couleurs ont l'air de vous attendre, mais ils ne vous regardent pas,
ils ne vous voient même pas : ils espèrent quelqu'un d'autre.
Dans
cette mêlée de silhouettes, je découvre un petit carton sur lequel est
écrit mon nom : le Professeur C. est venu me chercher, barbe poivre et
sel, jeans, chemise à carreaux, tel exactement que je me l'imaginais.
Nous nous saluons poliment. Cet homme est sympathique.
Dehors, une
forte odeur de kérosène. Ma première bouffée d'air. L'Amérique a donc
une odeur. Nuit tiède, lumière jaunâtre. Des chariots se croisent, des
bagages s'empilent, des limousines stationnent, des autobus débarquent
des grappes de voyageurs : ce sont les détails ordinaires de n'importe
quelle gare, mais je bois avidement, comme un alcool nouveau, l'air
électrique de la nuit américaine.
Le
Professeur C. m'installe dans sa vieille bagnole : une Chevrolet Nova,
de couleur caca d'oie, achetée au Texas. Quelques livres, quelques
journaux épars sur la banquette arrière. Premières avenues, premiers
palmiers, première circulation sur la highway 405, en direction de
Westwood. Six voies dans chaque sens. Longue glissade dans la nuit. Le
trafic est fluide. Nous parlons un peu de mon voyage, de l'organisation
de mon séjour, des quelques cours que je donnerai à U.C.L.A. Le
Professeur C. est d'origine Suisse : il parle avec un curieux accent,
mi californien, mi vaudois, à l'évidence heureux d'être ici et d'avoir
échangé ses tickets de téléphérique contre un permis de séjour illimité
dans une immense salle de cinéma.
Le
long de l'autoroute, toujours les mêmes constructions basses, sans
charme, sans perspectives. Rien ne ravit l'oeil ou l'étonne, sinon le
gigantisme des panneaux publicitaires. Seuls, au loin, les gratte-ciel
de Downtown me rappellent aux anciens clichés d'une Amérique
prométhéenne avide de puissance et de prouesses. Par ici, rien qui
vaille un détour. Mon espérance candide n'est pourtant pas déçue : sans
que je sache très bien pourquoi, la conviction s'impose que cette
banalité même a un sens. Elle sonne juste. Quelque part, elle doit être
justifiée. Un curieux sentiment d'espace et d'ouverture l'accompagne et
l'absout. Cette absence de composition ne contraint le regard à se
poser sur rien : il laisse la conscience libre. C'est là ma première
découverte. Aucun des films que j'avais vus au cinéma ne m'avait
procuré une pareille sensation : il faut avoir posé le pied sur le
territoire américain pour que sa superficie devienne enfin réalité.
Je loge sur
Veteran avenue, non loin d'un cimetière de croix blanches. Tard dans la
nuit, le Professeur C. m'a déposé là, avec ma valise. Enfin seul, je
visite : deux grandes pièces peintes en blanc, avec un coin cuisine, un
bar, une télévision, une fausse cheminée à l'ancienne, dissimulant la
bouche de climatisation, et d'immenses placards qui resteront vides. Le
cabinet de toilette est pourvu de deux souffleries, l'une d'air chaud,
l'autre d'air frais. Des moustiquaires doublent les baies vitrées. Pas
une image aux murs : tout est correct, confortable, fonctionnel. Un
petit balcon donne sur une rue calme. Le quartier est chic, safe comme on dit ici : on y peut faire du jogging ou promener son chien.
Crépi
d'un rose sali, cet immeuble compte quatre étages. On y trouve une
piscine, une laverie, une salle de ping pong et de billard où du café
est offert le dimanche. Des universitaires étrangers, des hommes
d'affaires, et quelques étudiants argentés composent la population
changeante de l'endroit où les appartements sont pour la plupart loués
au mois. Ce n'est pas un logis où s'installer, juste un lieu de
passage. Le contraire d'une pension de famille. On y vient travailler
ou dormir : l'essentiel se passe au-dehors.
L'une
des principales artères de la ville, Wilshire avenue, reliant Beverly
Hills à Santa Monica, est à deux pas : la circulation automobile ne s'y
interrompt jamais. Là non plus, rien à voir : pas de boutiques, pas de
vitrines, seulement des kilomètres de bitume et d'immenses trottoirs
déserts. Seul le quartier de Westwood, où s'additionnent les cinémas et
les restaurants, de l'autre côté du boulevard, concède au piéton
quelque espace : quatre ou cinq rues proches du campus de l'Université
s'animent le vendredi soir. Je remets au lendemain ces découvertes,
avale un somnifère et m'endort.
A
huit heures du matin, me voici à manger des patates, du lard et des
oeufs brouillés dans un fast-food de Westwood, en regardant défiler les
joggers et les voitures. La voilà donc enfin, mon Amérique ! En ce
dimanche de Pâques, pour la première fois, je me l'approprie. Le temps
et l'espace devant moi, ouverts en grand. Tel le gamin Rimbaud entrant
à Charleroi dans son Cabaret-vert. Commandant des tartines dans un
mauvais anglais. Buvant du café tiède et fade, de ce café clairet dont
l'Amérique est fière, cent fois "bouillu" sur le comptoir. Confus,
écoeuré, mais content. Donald a marché sur la lune, moi je suis assis
dans un bar au pays de Donald. Seul comme un oeuf au fond d'un plat. Le
coeur vaguement brouillé, à cause du décalage horaire. Mais déjà pris
au piège de l'autosatisfaction américaine, comme si ce gobelet en
plastique rempli de lavasse possédait la vertu d'un philtre et
suffisait à me donner accès à je ne sais quelle condition supérieure.
Il suffit de pas grand chose pour devenir américain : un blue jean, un
air détendu, un gobelet de plastique plein de café ou de coca. Pour le
reste, les noms s'en occupent : Hollywood, Beverly Hills, Santa Monica,
Malibu... Vous faites partie de la secte de ceux qui ont croisé le
chemin des stars, rôdé aux abords de leurs villas, emprunté les mêmes
rues et marché sur les mêmes trottoirs. Votre "moi" s'en trouve
augmenté. C'est dire que vous vous lestez d'un seul coup des images de
tous les films et des paroles de toutes les chansons : les rêves du
monde sont à vous qui mâchez des patates en technicolor dans un banal
fast-food de Westwood, le dimanche de Pâques 94, sur le coup de huit
heures.
L'air
vaguement chinois, un garçon m'apporte deux flacons jumeaux : "Tomato"
et "Tabasco". Je n'aime pas le ketchup. L'Amérique serait-elle une
purge ?

Ce
pays n'a pas de substance. Passée l'excitation, je n'en découvre que le
vide. Il sonne creux. Je ne peux m'y appuyer sur rien. Je ne sais
comment m'y orienter. Nulle part, je ne parviens à isoler quelque
élément qui me donnerait l'échelle de l'ensemble, le mode d'emploi, la
direction à prendre. Tout flotte, libre d'attaches. Me voici égaré dans
une civilisation qui paraît avoir subi une gigantesque psychanalyse et
qui l'inflige à son tour à quiconque la découvre.
Ma
cure a commencé. Intense vexation narcissique. Je ne suis plus rien. Je
n'existe pour personne, personne ne me regarde. Sur les trottoirs de
Paris, des regards se promènent, vous attrapent un instant, vous
retiennent, puis vous abandonnent : ils peuvent vous laisser croire que
vous existez dans les yeux d'autrui. A Los Angeles, cette économie
oculaire se trouve réduite à néant. Les passants se côtoient sans se
voir. Ils n'ont pas de visage, puisqu'ils ne se dévisagent pas. Vous ne
rencontrez ni hommes ni femmes, vous croisez des têtes et des corps. Je
connaissais la solitude, je découvre cette fois l'isolement.
Nothing to say to
nobody. Ici, l'on ne parle pas, on sourit. J'ai perdu ma langue, je prends quelques notes rageuses en anglais :
Here you are sure you are nothing. And you have just to pay and
die.
Ce monde n'est pas pour moi. Rien ne m'est destiné. Pauvre type qui
croyais que des choses ou des gens, l'attendaient quelque part.
Insignifiante baudruche : la voici donc, ton Amérique, elle n'est rien
d'autre que la réfraction de ton propre vide. Coup de spleen à huit
heures face à du jus de chaussette. Serais-je venu jusqu'ici pour ne
plus rien comprendre à rien ? Briser les rares repères qu'il me restait
? Je ne savais pas, avant ce jour, à quel point je pouvais être
européen...
Il se pourrait pourtant que la Californie soit l'une de mes provinces...
Réagir
: j'appelle un taxi et retourne à l'aéroport afin d'y louer une
voiture. Dans cette mégapole, on n'existe pas quand on ne circule pas.

C'est
une grosse Ford verte, avec une plaque d'immatriculation blanche aux
chiffres bleus. Je l'ai choisie pour sa rusticité, dans un catalogue de
cylindrées puissantes et multicolores. Rouge pompier, rose ice-cream,
jaune citron, vert fluo, ou bleu californien, par ici les voitures sont
gaies. En France, la couleur à la mode est le gris métallisé. C'est la
robe officielle de l'élégance et du centralisme républicain, la teinte
du costume de fonction et de la culture bien tempérée. De ce côté de
l'Atlantique, le chic est une catégorie obsolète; c'est plutôt le
soleil et le désir qui décident. Expansion de la personne, la voiture
est comme son habit : décapotée, décontractée, d'allure joyeuse.
Je
découvre les charmes de la boîte automatique : elle supprime les
à-coups et les vibrations. Peu de bruit : la voiture ne roule pas, elle
glisse. Aussi devient-elle aisément une sorte de salon. On y vit vitres
fermées, dans un micro-monde climatisé, au son de la radio. Si les
routes n'étaient pas en si piteux état, on se croirait parfois sur un
tapis volant. D'ailleurs, ces voitures magiques sont équipées de telle
sorte que l'on peut aisément les conduire sans les pieds : quand les
autoroutes sont interminablement droites, deux boutons sur le volant
suffisent à accélérer puis stabiliser l'allure. On peut se détendre,
faire du yoga, ôter ses chaussures et se délasser les pieds. On conduit
d'une seule main, un verre de soda dans l'autre. La vitesse étant
limitée, on ne s'énerve pas. Les conducteurs sont calmes, disciplinés
et polis. Pas de queues de poissons à la mode sicilienne, ni de
démarrages en trombe au feu vert. La conduite devient un plaisir
bourgeois : elle n'essaie plus de prendre l'espace de vitesse, elle le
réconcilie avec le temps. On mesure son voyage en heures plutôt qu'en
kilomètres.
Dans
ma grosse Ford, je prends mes aises. Mes états d'âme se dissipent. Ce
qu'un repas frugal et un verre de mauvais café n'avaient pas su rendre
possible, la voiture l'accomplit : me voici pour de bon américain,
californien plutôt, c'est-à-dire mobile, automatique et climatisé,
telle une goutte de sang pourvue d'une plaque minéralogique et
circulant en direction de l'Océan dans l'une des artères monumentales
de la cité des anges.

L'Océan
et moi, tout de suite, nous nous sommes reconnus. C'est une si vieille
histoire d'amour, ces rendez-vous avec le bleu ! Il ne m'a pas fallu
longtemps pour descendre Sunset boulevard en sinuant parmi les villas,
vers l'horizon du Pacifique. Mon exaltation est sans borne, quand au
volant de mon engin je roule sur la Pacific Coast Highway en direction
de Malibu. Ce ne sont pas des rêveries cinématographiques qui me
dérangent alors l'esprit, mais simplement le voisinage idéal de la
route et de l'eau : chaque point de vue sur le large renouvelle mon
bonheur de vivre.
Je n'ai pas tardé à découvrir que les endroits les plus intéressants de la côte sont les
Piers
: ces vastes môles de bois, construits sur pilotis, qui avancent dans
l'Océan. Ils constituent, en bordure de la ville, les seuls lieux où
l'on ait plaisir à flâner : on y entend sous ses pieds battre les
flots, on y regarde les bateaux, les pêcheurs et les otaries, on y
considère les perspectives de la côte, la dégringolade des collines et
les lisières de la cité dont les tumultes s'éteignent ici, relayés par
le déferlement incessant des rouleaux du Pacifique. Ces Piers sont pourvus de bancs et de tables largement espacés, de restaurants de
sea food et de quelques boutiques. On y vend des hameçons pour les pêcheurs et des souvenirs pour les touristes.
A
Santa Monica, j'ai ainsi élu domicile, face à l'Océan, devant une table
de bois peinte en bleu, couverte de tags argentés et de crottes de
mouettes, assis sur un banc bleu, auprès d'une poubelle bleue, de
lampadaires bleus et de rambardes bleues. J'ai mangé des crevettes et
des frites, en tournant le dos à l'Amérique et en lorgnant du côté de
la Chine. Parfaitement heureux et mortel dans la lumière du jour, ayant
à portée de la main toute la beauté du monde.
Pour télécharger ce livre sur Apple store :